
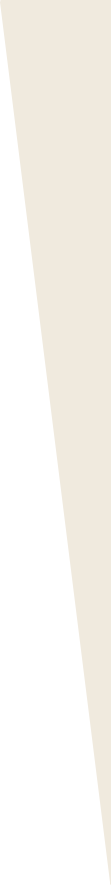
Les chercheurs
Katrin Rougeventre
LE THÉ, OU L’ESPOIR D’UNE VIE MEILLEURE POUR LES PLANTEURS ?
Katrin Rougeventre est chercheuse à l’INALCO (Institut national des langues et civilisations orientales) au sein de l’IFRAE (Institut Français de Recherche sur l’Asie de l’Est). Elle se consacre depuis de nombreuses années à l’étude du thé en Chine. Aujourd’hui, son travail de thèse porte sur les problèmes des théiculteurs chinois, confrontés aux changements climatiques et aussi au développement de villes et d’usines sur les terres où ils cultivaient autrefois le théier. En quelques années, la géographie du thé a été totalement bouleversée. Katrin rencontre les producteurs pour comprendre quelles conséquences cela a sur leur vie, sur l’économie, et sur l’environnement.
théier, ou Camellia sinensis, est un arbre découvert en Chine il y a plus de 5000 ans. En chinois, le mot thé s’écrit 茶 (cha), un caractère constitué de trois parties : l’herbe 草, l’homme 人 et l’arbre 木. C’est une image symbolique d’un homme cueillant des feuilles de thé sur un arbre.
Jusqu’aux années 1980, la culture du thé se limitait surtout à l’Est, sur les collines et en plaine. À l’Ouest, les villageois, souvent pauvres, cultivaient le riz. Leurs théiers, des arbres sauvages parfois millénaires, étaient sacrés. Leur cueillette restait rare et réservée à une consommation locale.
Katrin s’intéresse à l’évolution de la culture du thé, ou théiculture, en Chine, et à ses répercussions sur les populations, l’environnement et l’économie. Ses recherches portent sur le développement durable du thé. Pour comprendre ces transformations, elle se rend sur place, jusqu’aux villages les plus reculés, afin de rencontrer les producteurs et d’étudier leurs pratiques. Elle consulte également des archives chinoises pour retracer l’histoire et les mutations de cette culture.
Elle a ainsi constaté que l’urbanisation rapide et le développement des industries à l’Est ont repoussé les jardins théiers vers l’Ouest, où ils ont remplacé les rizières. Ce déplacement, encouragé par le gouvernement, a contribué à sortir certaines régions montagneuses de la pauvreté. Dans cet exemple, le changement semble bénéfique. Mais est-ce toujours le cas?
Fiche publiée en 2025.
- Identifier les principales contraintes de la théiculture en Chine : changement climatique, urbanisation, industrialisation, vieillissement de la population, évolution de la demande…
- Analyser les solutions proposées pour y faire face.
- Vérifier sur le terrain, avec les producteurs, comment ces nouvelles directives sont appliquées et perçues.


