
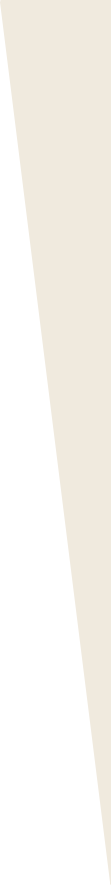
Les chercheurs
Margaux Herbrich
La production du fer dans les sociétés anciennes de Bourgogne-Franche-Comté
Margaux Herbrich est jeune chercheuse en archéométallurgie, aux laboratoires IRAMAT (Institut de recherche sur les ArchéoMATériaux, laboratoire de Métallurgie et Culture à Belfort) et ARTEHIS (Laboratoire Archéologie, Terre, Histoire, Sociétés à Dijon). Elle étudie la production du fer en Bourgogne-Franche-Comté, de l’âge du fer (-800 av. J.-C.) jusqu’au Moyen Âge (1500 ap. J.-C.). Ses recherches portent sur l’étape de réduction du minerai de fer dans des fourneaux, un processus important où le minerai est transformé en métal. Une des rares traces de cette activité qui restent aujourd’hui sont les « scories », les principaux déchets de cette étape de fabrication. Margaux étudie ces scories grâce à différentes méthodes d’analyses. Cela lui donne de nombreuses informations pour mieux comprendre les techniques et procédés métallurgiques anciens.
En France, entre l’âge du fer et le Moyen Âge, pour produire du fer, le minerai était extrait des gisements, puis transporté vers des ateliers où il était transformé dans des bas fourneaux. Cette étape, appelée « réduction », permettait de séparer le métal de la roche. Cela produisait une masse métallique hétérogène et générait des déchets en grande quantité, appelés scories. La masse métallique était ensuite travaillée pour être envoyée à la forge.
En Bourgogne-Franche-Comté, plus de 5 000 ateliers de réduction du minerai ont été identifiés : une production parfois très intense, faisant de cette région l’une des principales zones de production de fer à l’échelle nationale.
Margaux analyse comment cette production était organisée dans cette région. Il existe peu de documents anciens sur cette étape, mais les scories se trouvent toujours sur les sites de production. Elle les utilise comme de précieuses archives. Comment les ateliers étaient-ils organisés ? Quelle quantité de métal pouvaient-ils produire avec les matériaux disponibles ? Margaux tente de répondre à ces questions en analysant la composition chimique et la quantité de ces déchets.
Pour cela, Margaux se rend sur plusieurs sites de production en Bourgogne-Franche-Comté. Sur place, elle prélève des échantillons de scories, de minerais et de parois de fours, qu’elle analyse grâce à des techniques innovantes comme la fluorescence X. Elle combine également ces données avec des relevés LiDAR, qui permettent de modéliser les sites en 3D.
Margaux a déjà montré qu’en Bourgogne-Franche-Comté, l’étape de réduction du minerai était bien plus organisée et maîtrisée qu’on ne l’imaginait. Ses premiers résultats révèlent un savoir-faire technique remarquable comme en témoignent les grandes quantités de déchets retrouvés sur place, indiquant une production significative de fer à certaines périodes.
Fiche publiée en 2025.
- Analyser l’organisation de la production du fer dans les sociétés anciennes de Bourgogne-Franche-Comté, de l’âge du fer jusqu’au Moyen Âge
- Développer une méthode pour quantifier les volumes de fer produits et échangés, basée sur la combinaison d’analyses chimiques à la fluorescence X, de modèles 3D et de prélèvements sur le terrain
- Concevoir des outils permettant d’appliquer cette méthode à d’autres zones de production de fer en France pour les comparer


